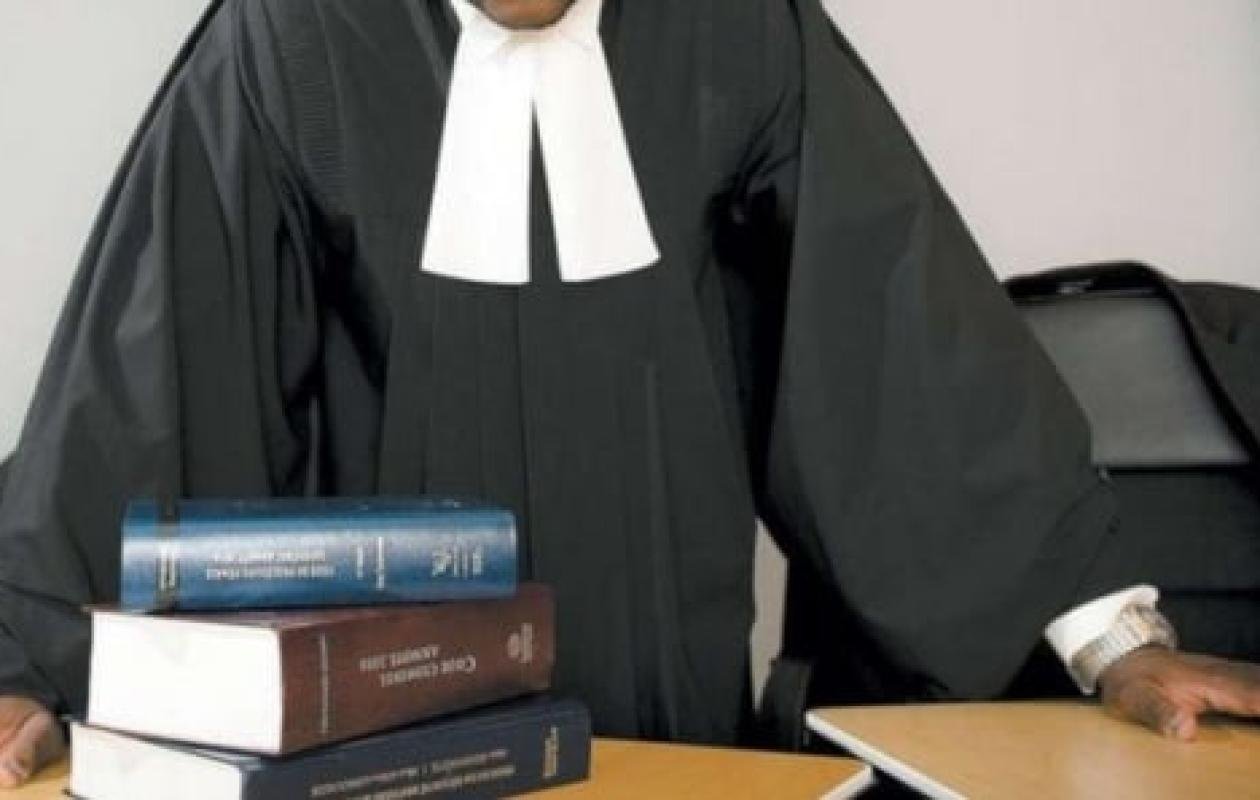Dakar, 06 août (SL-INFO) – Quand l’État se décidera-t-il à redéfinir le droit de grève, particulièrement dans le service public ? C’est la question que je pose depuis plus d’une décennie sans écho ni de l’État, ni de la société civile à laquelle j’appartiens.
Les journées de grève « décrétées » régulièrement par les syndicats du personnel de la justice depuis plus d’un mois ont fini d’installer l’anxiété non seulement chez les justiciables, mais également chez d’autres Sénégalais en quête de documents d’état civil pour la constitution de dossiers devant déterminer leur avenir. Peu avant eux, c’était le personnel des collectivités territoriales qui a observé plusieurs mois d’arrêt de travail en revendication d’un statut comparable à celui des autres agents de la fonction publique nationale. Avant ces derniers également, la longue série de grèves dans l’enseignement a gravement affecté le secteur, avec des conséquences qui continuent encore à se manifester dans le calendrier scolaire et universitaire ainsi que dans les performances des élèves et étudiants. Le recours systématique à la grève est érigé en principale action syndicale.
Cette situation nécessite raisonnablement d’adapter notre législation à ce phénomène, pour assurer la paix et la tranquillité sociales afin de mieux affronter les difficultés économiques actuelles de notre pays. Il ne s’agit pas ici de contester la légitimité des revendications des uns et des autres, car le travail et la revendication au mieux-être du travailleur sont intimement et perpétuellement liés, mais plutôt de poser des limites dans l’exercice des droits et libertés pour préserver l’ordre social. La Constitution du Sénégal garantit à chaque citoyen des droits et libertés individuels et collectifs dans son article 8, dont « les libertés syndicales ». Plus spécifiquement, l’article 25 alinéa 4 dispose : « Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas, ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l’entreprise en péril. » Le Code du travail (articles L.274 et suivants) et la loi portant statut général de la fonction publique (article 7) vont dans le même sens en fixant un certain nombre de limites, telles que l’interdiction d’occuper le lieu de travail, empêcher les non-grévistes d’y accéder, etc. Ces limites sont actuellement insuffisantes pour maintenir l’équilibre entre la préservation du droit de grève et la garantie des droits et libertés des autres citoyens exprimée dans le dicton « la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ».
Dans l’exercice de sa charge constitutionnelle de garantir à chaque citoyen la libre jouissance de ses droits et libertés, il revient à l’État d’en fixer souverainement les règles. C’est dans ce sens que se situe la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui énumère de façon exhaustive les droits et libertés individuels et collectifs tout en conditionnant chaque énoncé de liberté au respect, entre autres, de la « sécurité collective » et de l’« intérêt commun ». Elle reconnaît aux États le droit et le devoir d’imposer « des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements… dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes ».
C’est ainsi que le Bénin a introduit, en 1998 et 2022, dans sa législation, des restrictions au droit de grève dans les secteurs de la sécurité, de la santé, de la justice, des transports, entre autres, allant jusqu’à limiter à dix (10) jours par an le droit de grève dans chaque secteur. L’Union européenne, dans le même sens, exclut expressément de son champ de compétence le droit syndical, d’association et de grève, laissant libre et soutenant totalement les États membres dans la réglementation en la matière.
Sous ce rapport, le Sénégal ne peut pas se passer d’une réforme de sa législation en matière de droit de grève pour limiter ou éradiquer les entraves durables aux services publics et protéger ainsi le droit des autres citoyens d’accéder à leurs prestations. De notre point de vue, les règles suivantes doivent être introduites :
– Dans l’enseignement et la formation, il y a lieu de sécuriser le droit des apprenants au déroulement complet du programme annuel en fixant un quantum horaire minimal des cours et un calendrier impératif des évaluations (devoirs, compositions et examens).
– Dans le secteur de la santé, assurer la permanence des services d’accueil et d’urgence, la continuité des programmes de vaccination des femmes et des enfants.
– Dans la justice, la grève doit être limitée exclusivement aux audiences.
– Pour tous les services publics, instaurer un service minimum par au moins le tiers du personnel, en interdisant les pratiques suivantes :
– La « grève perlée », qui consiste à prendre son service mais à ralentir son travail ou exécuter son travail de manière partielle ou défectueuse.
– La « grève du zèle », qui consiste à appliquer à la lettre toutes les consignes de travail avec un perfectionnisme exagéré des tâches confiées, ce qui a pour effet de ralentir ou de rendre impossible l’activité.
– La « présence négative », qui consiste à venir occuper son poste de travail et « croiser les bras ».